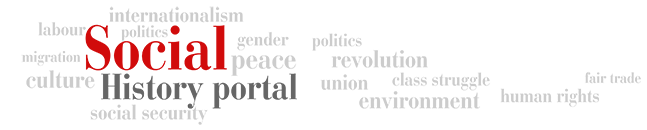Ce numéro de Moussons propose d’interroger ensemble les rapports sociaux de sexe, les mobilisations féministes et les politiques de promotion des droits des femmes et des minorités de genre en Asie du Sud-Est, en explorant leurs traductions, leurs tensions et leurs effets à différentes échelles. Il entend contribuer à une lecture décoloniale et située des politiques de genre en Asie du Sud-Est, en portant une attention particulière aux interactions entre dynamiques globales et ancrages locaux, entre institutions normatives et mobilisations collectives, entre héritages coloniaux et transformations contemporaines. Il vise à valoriser la pluralité des voix et des épistémologies féministes et des minorités de genre de la région, en soutenant la traduction et la circulation de travaux issus des langues vernaculaires d’Asie du Sud-Est vers le français ou l’anglais, afin de favoriser une mise en dialogue inclusive.
Argumentaire
La conférence mondiale sur les femmes de Pékin en 1995 a marqué un tournant pour les mouvements féministes en Asie du Sud-Est. La participation active d’associations féministes de la région y a favorisé l’émergence de réseaux transnationaux et la diffusion de nouvelles catégories d’action publique autour du gender mainstreaming (intégration de la dimension de genre). L’écho de cet événement s’est traduit par une institutionnalisation progressive des enjeux de genre au sein des politiques publiques et du secteur associatif : création de ministères ou d’unités dédiées à la promotion des femmes, intégration du genre dans les programmes de développement, et reconnaissance accrue des organisations féminines comme interlocutrices légitimes des États et des bailleurs internationaux. Si les décennies ont largement suscité des études en ce domaine, notamment sous l’angle de la diffusion et de la standardisation des politiques de genre, les transformations plus contemporaines, marquées par la reconfiguration des féminismes, la montée de nouveaux acteurs et les tensions demeurent encore peu documentées.
Ce numéro de Moussons propose d’interroger ensemble les rapports sociaux de sexe, les mobilisations féministes et les politiques de promotion des droits des femmes et des minorités de genre en Asie du Sud-Est, en explorant leurs traductions, leurs tensions et leurs effets à différentes échelles.
Il s’agira d’explorer les configurations du genre dans la région, à travers des enquêtes empiriques, des analyses théoriques et des réflexions comparatives. Une attention particulière sera accordée aux formes de division socio-sexuée du travail et à ses métamorphoses, qu’elles concernent les sphères domestique, productive ou reproductive, les migrations, ou encore les économies informelles et transnationales. Quelles grilles d’intelligibilité du genre prévalent dans différents contextes historiques et politiques, et comment participent-elles à la production – ou à la contestation – des normes sociales ? Qu’elles soient héritières d’histoires localisées, importées par des institutions religieuses, étatiques ou internationales, comment ces normes entrent-elles en contradiction selon les configurations de pouvoir et les périodes considérées ?
Les propositions pourront également porter sur l’examen critique des politiques publiques et des dispositifs internationaux de promotion des droits des femmes et des minorités de genre, ainsi que sur leurs effets concrets au niveau local : appropriations, résistances, détournements ou reconfigurations. Comment les normes internationales issues des conférences onusiennes, des conventions ou des agendas de développement sont négociées et éventuellement contestées dans des contextes marqués par la pluralité religieuse, les héritages coloniaux, les nationalismes et les transformations socio-économiques contemporaines ? Loin d’adopter une approche homogénéisante de la « globalisation du genre », ce numéro entend rendre compte des dynamismes contradictoires qui accompagnent la mise en œuvre des politiques du genre en Asie du Sud-Est. Il permettra d’explorer les tensions entre universalisation des droits et ancrages locaux, entre professionnalisation du militantisme et maintien d’espaces critiques féministes, entre dépendance institutionnelle et réappropriation stratégique.
Les contributions pourront aborder, entre autres, la fabrique institutionnelle des politiques d’égalité (plans d’action nationaux, ministères, agences internationales) et leurs logiques de mise en œuvre ; les formes de traduction et de vernacularisation du genre dans les contextes religieux, coutumiers ou communautaires ; les dynamiques de professionnalisation, d’expertise et d’ONGisation du militantisme féministe et LGBTQ+ ; les formes de résistance, d’adaptation ou de réinvention portées par les actrices et acteurs locaux face aux cadres internationaux.
Ce numéro entend contribuer à une lecture décoloniale et située des politiques de genre en Asie du Sud-Est, en portant une attention particulière aux interactions entre dynamiques globales et ancrages locaux, entre institutions normatives et mobilisations collectives, entre héritages coloniaux et transformations contemporaines. Il vise à valoriser la pluralité des voix et des épistémologies féministes et des minorités de genre de la région, en soutenant la traduction et la circulation de travaux issus des langues vernaculaires d’Asie du Sud-Est vers le français ou l’anglais, afin de favoriser une mise en dialogue inclusive.
Ce numéro thématique de Moussons accueille des contributions issues de l’ensemble des sciences humaines et sociales (anthropologie, sociologie, histoire, science politique, études de genre, etc.).
Modalités de contribution
Les propositions de contribution se feront sous la forme d’un texte de 750 à 1 000 mots. Elles devront comporter un titre, un résumé et une brève présentation de l’auteur·trice.
Les propositions de contribution sont à envoyer par courriel conjointement à Estelle Miramond et Samia Kotele aux adresses e-mails suivantes : estelle.miramond@u-paris.fr et kotelesamia@gmail.com,
avant le 8 janvier 2025.
En cas de réponse favorable (avant le 9 février), les articles complets seront à envoyer pour le 15 juin 2026.
Le format attendu est de 35 000 à 75 000 signes maximum (notes de bas de page et espaces comprises).
Les contributions en anglais sont les bienvenues.
Pour plus d’informations et avant soumission, merci de consulter la rubrique des conseils aux auteurs de la revue Moussons
Les articles seront relus par les responsables scientifiques et un ou plusieurs membres du comité éditorial avant d’être évalués selon le processus habituel de double évaluation externe et anonyme. La parution du numéro est prévue en juin 2027.
Responsables scientifiques
- Estelle Miramond (LCSP-UPC)
- Samia Kotele (ENS Lyon-IAO)
Biographie des responsables scientifiques
Estelle Miramond est maîtresse de conférences en sociologie (LCSP-IHSS) et co-directrice du Centre d’enseignement, de documentation et de recherches en études féministes (CEDREF) à l’université Paris Cité. Ses recherches concernent les questions de migrations, sexualités, travail et exploitation. Après avoir étudié les politiques de lutte contre la traite des femmes entre le Laos et la Thaïlande, elle travaille désormais sur la bioéconomie de la reproduction.
Samia Kotele est docteure en histoire de l’École normale supérieure (ENS) de Lyon. Ses recherches portent sur l’histoire intellectuelle et sociale des femmes oulémas indonésiennes, en mobilisant l’histoire des concepts, l’ethnographie collaborative et des enquêtes archivistiques transrégionales. Ses intérêts de recherche incluent également la réforme islamique, les formes d’autorité genrée et les méthodologies féministes et décoloniales en Asie du Sud-Est.