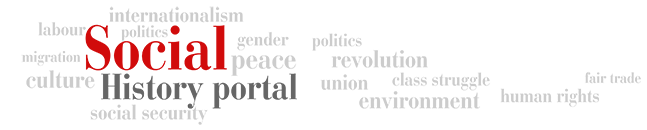Paris/France
Cette journée d’étude s’inscrit dans la continuité des recherches féministes sur l’histoire de l’architecture et de l’espace, qui, depuis la deuxième partie du XXe siècle, interrogent les effets du patriarcat sur la production et les récits architecturaux. Elle vise à prolonger ces travaux en s’intéressant au contexte français du long XIXe siècle (1789-1914). L’objectif est de cartographier les discours féminins et féministes sur l’environnement construit diffusés dans la presse et l’édition en France. Cette approche entend révéler les réseaux, les supports et les thématiques portés par les autrices, tout en replaçant la France dans un cadre de réflexion transnational. Nous souhaitons accueillir des propositions émanant d’horizons disciplinaires variés, au-delà du champ de l’architecture.
Argumentaire
Depuis les années 1970, des architectes, historien·ne·s féministes écrivent une histoire des villes, de l’architecture et de l’habitat à travers le prisme du genre, pour reconstruire une histoire des femmes qui pensent l’espace. Ces recherches se sont révélées fondamentales non seulement pour écrire l’histoire des femmes, mais surtout pour écrire une nouvelle histoire (Thébaud 1998). Par ces recherches, le genre devient une « catégorie utile d’analyse historique » (Scott 1988) à part entière qui engage la décomposition des effets d’une société patriarcale sur la construction de récits architecturaux.
Cette journée d’étude s’inscrit dans une histoire transnationale qui a déjà été menée notamment aux États-Unis sur les « féministes matérielles » (Hayden 1981/2023) mais aussi en prenant en compte le travail des femmes architectes en général et non pas en se concentrant sur les exceptions connues (Torre 1977). C’est dans le souci de déplier les différents dispositifs spatiaux, les dynamiques genrées au sein de la profession et la reconfiguration critique de l’histoire de l’architecture prenant en compte les voix des femmes et les questionnements portés par les mouvements féministes qu’une large littérature s’est développée. Si cette dernière est à prédominance anglo-américaine, de nombreux mouvements, projets et figures ont été étudiés à l’international, on pense en particulier à l’Allemagne (Uhlig 1981 ; Terlinden, von Oertzen 2006), au Danemark (Vestbro 1982), aux Pays-Bas (Novas Ferradas 2023, 2024), et à la Belgique (Vranken 2018).
En France, l’histoire de l’architecture au féminin a été précédée par une vague de travaux de sociologues sur les enjeux liés à la féminisation de la formation et de la profession d’architecte en France (Chadoin 1998 et 2002 ; Lapeyre 2003). Elle s’est d’abord concentrée sur les pionnières, dans une logique de rattrapage après des décennies d’historiographie ayant globalement invisibilisé les femmes architectes. Deux grands axes se détachent : celui la féminisation des études d’architecture et de la profession depuis la fin du XIXe siècle (Diener 2013 ; Giaquinto 2016 ; Girard et Ringon 2019 ; Bouysse-Mesnage 2022 et 2023a), porté par le programme de recherche sur l’histoire de l’enseignement de l’architecture en France au XXe siècle (HENSA20), et celui de leur apport à la production théorique et construite française, principalement moderniste (Koering 2016, 2018 et 2023 ; Bouysse-Mesnage et al., 2023b ; Mittmann 2023a et 2023b). Cette dynamique s’est élargie parallèlement à l’histoire de la critique d’architecture au féminin, à laquelle sont consacrés depuis quelques années programmes (Barbut et Kramer-Mallordy) et travaux de recherche (Knockaert, en cours), événements scientifiques (Châtelet, Jannière, Scrivano 2023) et expositions (Szacka 2025). Cette dynamique s’est néanmoins concentrée sur le XXe siècle et sur quelques figures majeures de la critique d’architecture et d’urbanisme au féminin, françaises (Marie Dormoy, Françoise Choay) ou nord-américaines (Ada Louise Huxtable, Phyllis Lambert, et la critique féministe américaine).
Aussi important soit-il, ce rattrapage en cours n’a pas encore permis de répondre à une question pourtant cruciale : « Comment écrire [...] des histoires féministes de l’architecture sans femmes architectes ? » (Hultzsch 2022). La traduction en français et la publication récentes de textes charnières, principalement issus de la scène anglo-américaine, ayant abordé entre les années 1970 et 1990 une histoire de l’architecture prenant en compte plus largement l’apport des femmes et des mouvements féministes (Dadour 2022 ; Hayden 1981/2023), ont réactivé l’héritage de l’ouvrage pionnier sur l’histoire et l’actualité des utopies féministes (Denèfle 2009). Une thèse en cours autour de projets architecturaux féministes qui pensent la socialisation du travail domestique (Jonville, en cours) confirme ce regain d’intérêt pour une histoire féministe de l’architecture, complémentaire d’une histoire des femmes architectes (Bastoen 2024 ; Thibault 2014).
Un programme de recherche en cours, intitulé Women Writing Architecture: Female Experiences of the Built 1700-1900 et piloté par Anne Hultzsch depuis l’ETH Zurich, cherche à explorer la production discursive féminine sur l’architecture en évitant l’écueil de la survalorisation de l’individu concepteur (Willis 1998) : « L’écriture et la publication ont historiquement offert (et offrent encore souvent aujourd’hui) un espace aux femmes, et à d’autres groupes marginalisés, pour parler d’une voix publique, pour être entendus, pour pratiquer. Elles ont créé des réseaux intellectuels et des discours qui ont façonné la manière dont les bâtiments sont perçus, produits, compris et utilisés » (Hultzsch 2022). La France occupe néanmoins une position marginale parmi les terrains d’étude de la cinquantaine de chercheurs et chercheuses impliqués dans ce programme.
Notre ambition est donc de cartographier les recherches en cours sur les discours féminins et féministes sur l’environnement construit et paysager dans les presses généraliste, féminine et féministe et l’édition en France, dans le long XIXe siècle (1789-1914). Les contributions pourront attacher une attention particulière aux formes, supports, thématiques et dimension intertextuelle des discours ; aux trajectoires, stratégies auctoriales et réseaux des autrices ; à la réception de leurs discours, tout en replaçant la France dans un cadre de réflexion transnational.
Modalités de contribution
La participation prendra la forme d’une communication de 20 min pour les chercheur.se.s et les doctorant.e.s et une session sera dédiée aux étudiant.e.s de master sous un format Pecha Kucha (20 diapositives toutes les 20 secondes pour une présentation totale de 6 min 40).
Les propositions (titre + résumé de 300 mots maximum) sont à envoyer à julien.bastoen@paris-belleville.archi.fr et juliettejonville@gmail.com,
avant le 5 janvier 2026 au plus tard.
Calendrier
- Lancement appel à communication : mi-novembre 2025
- Date butoir pour l’envoi des propositions : 5 janvier 2026
- Réponse aux intervenant·e·s retenu·e·s : fin janvier 2026
Comité d’organisation
- Julien Bastoen, maître de conférences en histoire et cultures architecturales, ENSA Paris-Belleville, chercheur IPRAUS
- Juliette Jonville, doctorante en architecture, Université Gustave Eiffel, IPRAUS
Comité scientifique
- Lucie Barette, autrice, chercheuse en langue et littérature françaises, Laslar UR4256/Normandie Université
- Julien Bastoen, maître de conférences en histoire et cultures architecturales, ENSA Paris-Belleville, chercheur IPRAUS
- Stéphanie Dadour, maîtresse de conférences en histoire et cultures architecturales, ENSA Paris-Malaquais, chercheuse ACS
- Hélène Jannière, professeure HDR en histoire de l’architecture contemporaine, université Rennes 2, directrice de l’unité de recherche Histoire et critique des arts
- Juliette Jonville, doctorante en architecture, université Gustave Eiffel, IPRAUS
- Laetitia Overney, professeure HDR en sociologie, université Le Havre-Normandie, chercheuse Identité et Différenciation de l’Espace, de l’Environnement et des Sociétés (UMR CNRS 6266)
- Estelle Thibault, professeure HDR en histoire et cultures architecturales, ENSA Paris-Belleville, chercheuse IPRAUS