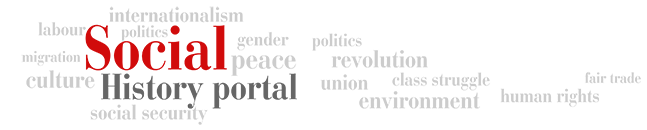Institut d'histoire sociale de la Fédération CGT des cheminots 263, rue de Paris - Case 546 - 93515 Montreuil Cedex
L’institut d’histoire sociale de la fédération CGT des cheminots lance l’organisation d’un colloque portant sur la grève de l’hiver 1986/1987, qui s’est étendue du 18 décembre 1986 au 15 janvier 1987, faisant de ce conflit (à ce moment-là) le plus long de l’histoire sociale des cheminots. Ce conflit avait notamment permis le retrait d’une grille des salaires « au mérite » rejetée par l’ensemble du corps social.
Ce conflit a durablement marqué l’histoire des luttes cheminotes pour des raisons qui ne tiennent pas seulement à la durée de la grève. Dans un contexte marqué par le recul important des effectifs syndicaux d’un côté, par l’entrée dans la première cohabitation de la 5ème République de l’autre, cette grève s’inscrit d’abord dans une séquence de renouveau des luttes sociales qui se manifeste de différentes manières. En cette fin d’année 1986, les étudiants sont notamment mobilisés contre le projet Devaquet alors ministre de l’éducation nationale. Parmi les agents de la SNCF, le conflit prend forme dans un contexte de durcissement des relations avec le gouvernement.
Dès le mois d’août 1986, le ministre Douffiagues avait accordé au Monde un entretien, reçu comme une véritable provocation par les syndicats. Le ministre y déclare notamment vouloir « ouvrir un débat » sur le statut du cheminot, au motif qu’il ne lui semble pas toujours justifié par des considérations techniques, et exige à la SNCF des comptes sur la façon dont elle dépense 33 milliards de francs de concours publics annuels. En riposte, la fédération CGT appelle à un rassemblement des cheminots de la région parisienne à la gare d’Austerlitz.
Cette mobilisation s‘inscrit dans un ensemble de 14 actions nationales initiées par le syndicat au cours de l’année 1986 chez les cheminots. Ainsi dès le 30 janvier contre la flexibilité du travail ; en février et mars contre les sanctions frappant les militants du train jaune de Cerdagne qui se sont opposés à son démantèlement. Une manifestation nationale des cheminots est organisée à Montpellier le 20 février pour défendre les militants du train jaune ; puis le 23 avril action contre la mise en oeuvre du contrat de plan État/SNCF prévoyant la suppression de 28000 emplois entre 1986 et 1989. Citons encore la forte mobilisation des agents de conduite et contrôleurs le 30 mai, et la semaine d’actions organisée du 20 au 25 octobre sur les salaires, l’emploi, les conditions de travail, les atteintes aux libertés syndicales, la défense du statut ; dans la foulée, du 10 au 16 décembre, s’enclenche la grève victorieuse des guichetiers des gares contre le retrait de la « prime de saisie »
Si la grève de l’hiver 1986 prend donc naissance dans un contexte d’intensification des luttes syndicales cheminotes, les conditions de son émergence et les modalités de son organisation en ont cependant aussi débordé les cadres habituels du travail syndical d’organisation des mobilisations. Le déclenchement de cette grève n’a pas été en effet impulsée par la CGT ni par une autre organisation syndicale, dont le rôle dans l’organisation de la lutte est aussi mis en question par l’émergence de coordinations, qui donnent une place centrale à la pratique de l’assemblée générale dans la conduite du mouvement. Autre trait distinctif de cette grève, sa temporalité, puisqu’elle s’enclenche et se poursuit pendant les fêtes de fin d’année. C’est là une autre rupture manifeste avec les stratégies syndicales habituelles de recours à la grève, qui préfèrent en règle générale éviter d’en faire usage à cette période, dans une logique de défense du sens du service public et de limitation des risques de stigmatisation de la lutte syndicale.
Au regard de ces différents éléments, ce colloque se propose de réinvestir l’étude de cette grève à partir d’une double ambition : celle de contribuer à une meilleure connaissance des ressorts de cette mobilisation et de ses effets, en encourageant pour cela la mise en perspective de recherches académiques et de témoignages militants permettant de décentrer le regard à partir duquel cette mobilisation a été le plus souvent appréhendée dans le champ scientifique. Outre que les travaux historiques spécifiquement centrés sur ce conflit restent rares, les sociologues s’en sont eux emparés à partir d’un prisme essentiellement centré sur l’objet des coordinations. Elles ont été saisies comme un révélateur de la crise du syndicalisme, qui s’est imposée, jusqu’à la fin des années 1990 comme le principal angle de questionnement à partir duquel les sciences sociales se sont intéressées aux questions syndicales. Sans remettre évidemment en cause l’intérêt de ces travaux, l’objectif de ce colloque est cependant de rassembler des contributions qui permettent d’élargir tout aussi bien les angles de questionnement que les échelles de l’analyse, en ne la réduisant pas notamment à ce qui s’est joué dans la région parisienne.
Comment le déclenchement et le déroulement de ce conflit a-t-il été appréhendé et accompagné (ou non) par les directions syndicales qui n’en avaient pas pris l’initiative ? Quelle place ont concrètement occupé les militants syndicaux (et lesquels) dans les coordinations ? Cette forme d’organisation de la lutte était-elle d’ailleurs généralisée sur l’ensemble du territoire ? Comment le « tabou syndical » de la grève pendant les périodes de fêtes de fin d’année a-t-il pu être levé ? Quelles résistances internes, quelles réactions politiques et médiatiques hostiles cela a-t-il pu engendrer ? Enfin, qu’a produit ce conflit, tant du point de vue de ses résultats revendicatifs immédiats ou à plus long terme (le retrait du projet de grille des salaires au mérite en particulier), que des formes d’adaptation et de redynamisation de l’action syndicale qu’il a pu encourager ? Plus que la fin du syndicalisme cheminot, ce conflit n’a-t-il pas davantage marqué son entrée dans une nouvelle séquence, posant les germes de la démarche syndicale qui aboutira au conflit de novembre et décembre 1995 ? Quel impact de la lutte et de ses formes sur les orientations et pratiques de la CGT au-delà de la seule fédération des cheminots ? Telles sont, parmi d’autres possibles, les questions que ce colloque se propose notamment de défricher.
Dans cette optique, les contributions pourront s’ordonner autour de quatre principaux axes de questionnement :
- Le moment du conflit et sa genèse
- effets du conflit sur le champ syndical CGT et autres
- effets sur les pratiques et les organisations
-
- expériences territoriales
- portée de ce conflit quatre décennies plus tard
Les archives de l’Institut d’Histoire Sociale de la CGT Cheminots pourront être exploitées en vue d’apporter des contributions originales au colloque
Conseil scientifique :
Baptiste GIRAUD, maitre de conférences en science politique, université Aix-Marseille, Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail
Paul BOULLAND, ingénieur de recherche, CNRS
Maryse DUMAS, membre du bureau de l’Institut CGT d’Histoire Sociale
Isabelle PASQUET, Patrick CHAMARET, Christian JONCRET, Pierre DELANOUE, membres du bureau de l’IHS CGT Cheminots
Contact :
colloque8687.ihs@cheminotcgt.fr
Pierre DELANOUE : 06 22 33 77 00